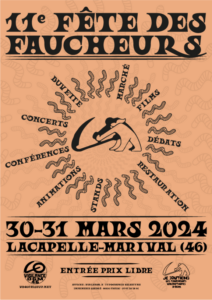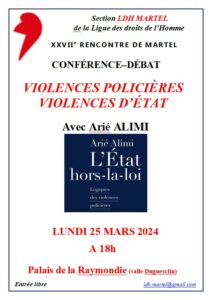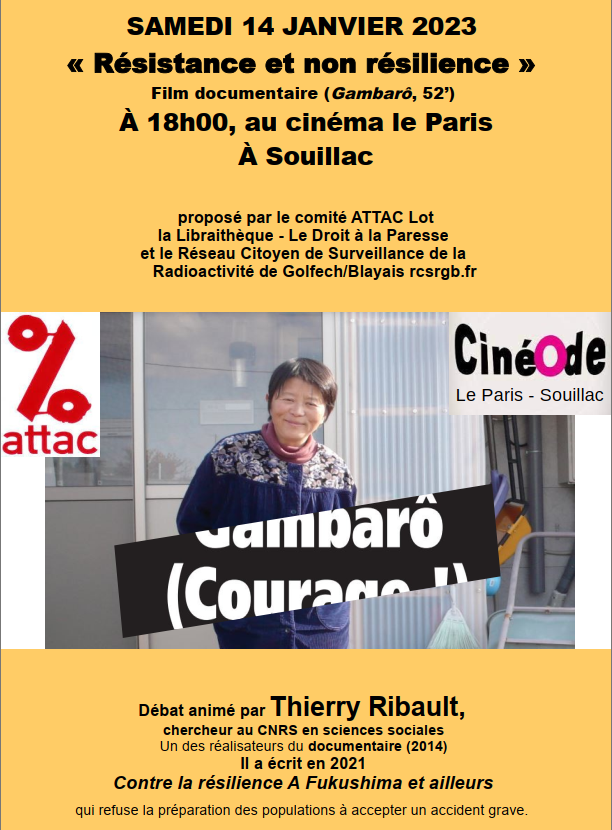Régulièrement nous relayons, l’avis de la Défenseure des droits sur des sujets d’actualité importants, ici il s’agit du projet de loi immigration et intégration.
Rappelons que le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens. Créée en 2011 et inscrite dans la Constitution, elle a deux missions : défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l’égalité de tous.
Auditionnée le 17 novembre 2023 par les rapporteurs de la commission des lois de l’Assemblée Nationale sur le projet de la nouvelle « loi immigration », la Défenseure des droits a alerté sur trois axes particulièrement problématiques :
- Le projet de loi multiplie les dispositifs de sanction et les mesures coercitives applicables aux étrangers, en se prévalant d’un objectif de protection de l’ordre public dont il ne s’agit évidemment pas de nier l’importance, mais dont les contours sont de plus en plus flous.
- Il accroît démesurément les exigences d’intégration concomitamment à une précarisation sans précédent du droit au séjour et de l’accès à la nationalité, au risque d’augmenter le nombre d’étrangers en situation irrégulière.
- Il remet profondément en cause les équilibres existants et menace ainsi les droits de tous, notamment en matière d’accès à la santé.
Dans l’intégralité de son avis de 97 pages, publié le 24 novembre, elle détaille les nombreux points de ce projet de lois qui posent problème. Cet avis est consultable ICI
Citons quelques mesures phares déplorées par la Défenseure des droits:
- La diminution des garanties procédurales attachées au placement et au maintien en zone d’attente des étrangers en cas d’arrivées simultanées sur le territoire d’un nombre important de personnes.
- La réduction drastique des voies d’accès au séjour, notamment des personnes dont la vulnérabilité particulière commanderait pourtant de leur assurer des protections renforcées, mais aussi en matière d’immigration dite « choisie ».
- La remise en cause du droit au séjour de longue durée des titulaires de la carte de résident, dont la vie privée et familiale est, par définition, établie en France.
- Des limitations inédites du droit de vivre en famille, y compris pour les réfugiés et les Français avec le durcissement des conditions d’accès au regroupement familial.
- Une fragilisation globale du droit au séjour acquis concourant au maintien, dans une insécurité administrative permanente.
- Une restriction conséquente des procédures d’accès à la nationalité française.
- Un droit au séjour sous caution pour les étudiants.
- Une profonde remise en cause du droit au séjour des étrangers malades qui n’est ni justifiée, ni souhaitable.
- La remise en cause de l’admission au séjour pour soins telle qu’elle est actuellement garantie par la France.
- La suppression de l’aide médicale d’Etat qui va à rebours de l’intérêt général en terme de santé publique et économique. Essentielle pour la santé des bénéficiaires, elle contribue à prévenir la propagation de maladies.
- La remise en cause du droit inconditionnel à l’hébergement d’urgence — Art. 19 ter A Le droit à l’hébergement d’urgence est consacré de façon inconditionnelle dans la loi, l’article L. 345-2-2 du CASF prévoyant que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Or, le projet de loi prévoit de revenir sur cette inconditionnalité à l’égard des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou déboutés de l’asile.
Régulièrement, la Défenseure des droits demande aux pouvoirs publics de mettre tout en œuvre pour produire une offre d’hébergement adaptée aux besoins, la sélection des personnes au regard de leur nationalité ne pouvant constituer la variable d’ajustement d’un dispositif qui, en dépit de la hausse substantielle du nombre de places ces dernières années, demeure inadapté à la demande.

Pour la Défenseure des droits s’exprimant dans une tribune du Monde le 9 décembre: « Un équilibre doit exister entre d’une part le droit souverain des États de décider des règles d’entrée et de séjour sur le territoire en tenant compte de l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, et d’autre part la nécessaire protection des droits fondamentaux. Le projet de loi bouleverse profondément cet équilibre, au profit de nouvelles formes d’ostracisme et au détriment de principes juridiques essentiels, en particulier les principes de dignité et d’égalité. Cette rupture dans la protection des droits et libertés en France emporterait des effets néfastes pour la cohésion sociale et l’intérêt général. »
Pour aller plus loin:
A Regarder et à entendre, la très éclairante émission A l’air Libre de Médiapart du 18 janvier 2024 sur le sujet, et ses remarquables invités qui nous expliquent en quoi cette loi est anticonstitutionnelle. ICI
A lire aussi » l’appel des 201 contre la loi immigration »: deux cent une personnalités d’horizons divers, dont l’ex-Défenseur des droits Jacques Toubon, appellent à marcher le dimanche 21 janvier dans toute la France pour demander au Président de la République de ne pas promulguer la loi immigration. ICI
Ou encore l’appel d’une centaine d’organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme. ICI