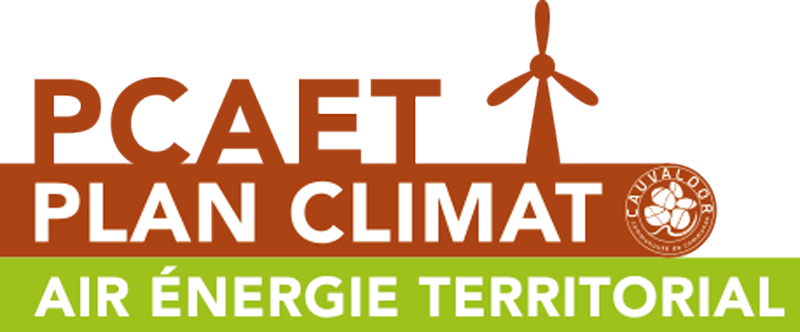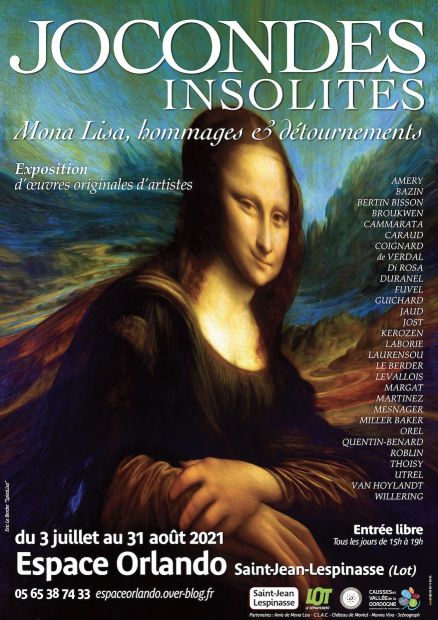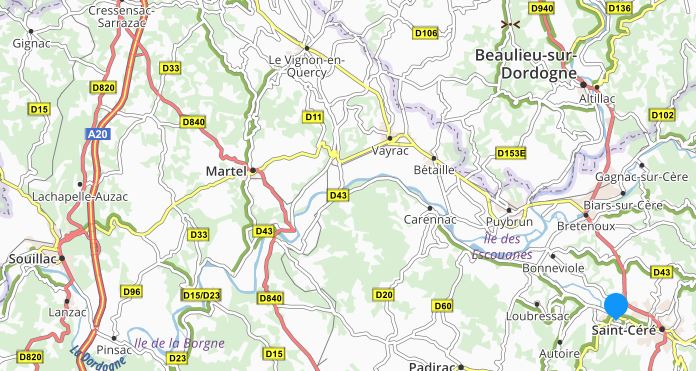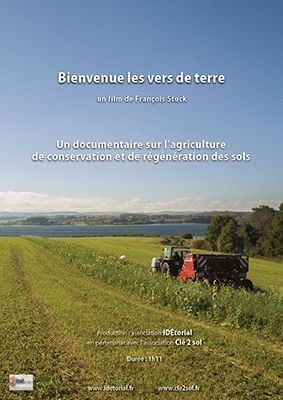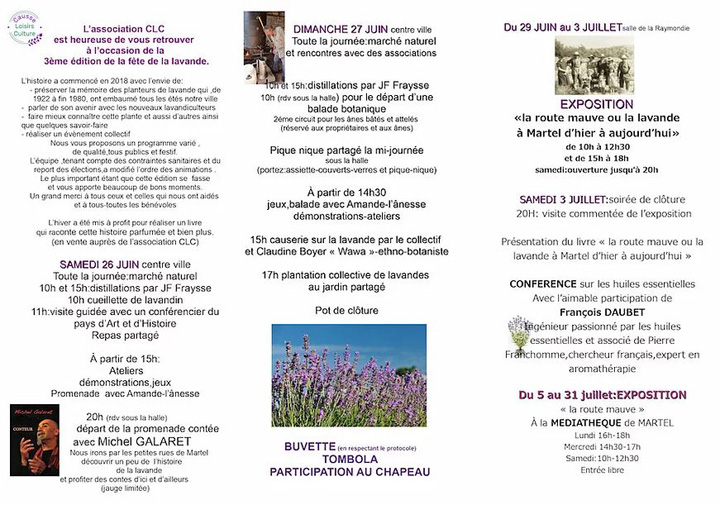Voici quelques remarques et éclaircissements faisant suite au dernier conseil municipal qui s’est tenu dans la salle des fêtes mercredi 16 juin (en annexe, vous trouverez le PV et des documents l’éclairant).
Délibération n°1 : Approbation du projet de Pacte de gouvernance de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne.
Pour commencer, François Moinet nous explique ce qu’est le « Pacte de gouvernance de CAUVALDOR » : Il s’agit avant tout d’un document de transparence qui doit rendre lisible et compréhensible l’intercommunalité, d’abord aux élus et ensuite aux administrés. C’est une nouvelle obligation de l’intercommunalité, mais ce pacte aura également pour objet d’éclairer tous les habitants quant au fonctionnement de cette structure portée par les maires (ou leurs délégués) des 77 communes rassemblées en son sein. À ce propos, notons que Gignac est une des deux seules communes, avec celle de Glanes, qui ont la particularité de ne pas être représentée par leur maire mais par un adjoint.
Vous trouverez dans ce long document (40 pages), mais réellement intéressant, l’historique des projets des 5 bassins de vie et leur équilibre territorial, la présentation des différentes structures de CAUVALDOR et la répartition des services et de leur 180 salariés, ainsi que le récapitulatif des compétences obligatoires et optionnelles de l’intercommunalité.
Délibération approuvée à l’unanimité des 12 conseillers présents et votants.
Délibération n°2 : Suppression des régies de recettes pour la cantine, le ramassage scolaire et l’encaissement des produits relatifs à la location de la salle des fêtes.
Pour faire court, nous dirons que cette délibération est rendue nécessaire par la mise en œuvre d’un nouveau système de paiement dématérialisé, et donc en ligne, pour les factures à régler au Trésor Public concernant la cantine, le ramassage scolaire et la location de la salle des fêtes.
Il convenait donc de supprimer les régies municipales existantes afin de rendre ce service de télépaiement totalement efficient.
On peut néanmoins se poser la question des paiements de la cantine pour les familles ne disposant pas de moyens de paiement adéquat : devront-elles se rendre à Souillac pour régler les factures en numéraire et cela sera-t-il même encore possible ?
Et qu’en sera-t-il pour les familles rencontrant des difficultés financières, car du fait de la mise en place de ce télépaiement, c’est directement l’appareil financier du Trésor Public qui sera l’interlocuteur de ces familles et non plus les conseillers municipaux qui pouvaient venir en aide à ces familles par le biais du CCAS ?
Cette délibération a été adoptée à l’unanimité des votants sans qu’à aucun moment les questions que nous soulevons n’aient été abordées.
Délibération n°3 : Tarifs et modalités de location de la salle des fêtes
Les modalités financières liées à la location de la salle des fêtes restent sensiblement les mêmes qu’auparavant, si ce n’est qu’une nouvelle ligne financière apparaît : celle d’un chèque de caution de 500 euros relatif au prêt de l’auto-laveuse pour le nettoyage de la salle. Ce prêt sera-t-il obligatoire ou bien sera-t-il possible de s’en tenir à un nettoyage manuel avec du matériel adéquat ? Il a été aussi question de la remise à niveau de ce matériel qui semble pour l’instant peu adapté à la taille de la salle.
Notons également le maintien de la mise à disposition gratuite de la salle pour les associations gignacoises contre un chèque de caution à la réservation de 400 euros alors que pour la location aux particuliers de la commune, ou même hors commune, cette caution n’est que de 250 euros. Ce qui nécessite donc pour une association communale le dépôt de 3 chèques de caution pour un montant global de 1000 euros lors d’une réservation !!!
Autre point non précisé dans le PV : il serait possible (sauf erreur de notre part) pour une association gignacoise de signer une convention à l’année pour la location de la salle des fêtes avec un dépôt de chèques de caution également annuel afin d’alléger la procédure.
Ce sont les deux agents du secrétariat de mairie qui auront la tâche de traiter ces locations.
Cette délibération a également été adoptée à l’unanimité des votants.
Divers : les points qui ont attiré notre attention
➢ « Le compte rendu de présentation du nouveau syndicat des eaux a été mis en ligne sur le site de la commune. »
Or, à ce jour (3 juillet), nous n’avons pas trouvé trace de ce document et c’est dommage car son étude ferait suite aux deux articles que nous avons publiés au sujet du Syndicat des eaux du Blagour.
➢ En ce qui concerne la formation ADEFPAT c’est Cauvaldor qui décidera si cette formation se fera car ce sont les intercoms qui adhèrent à l’association organisant ces formations. Comme nous vous l’annoncions lors d’un précédent article, cette formation visera exclusivement les élus et nous réitérons notre demande d’ouverture pour la participation d’autres porteurs de projet dans la commune. D’autant que cette formation ne sera pas entièrement prise en charge, 10 % restants à la charge de la commune.
➢ « Compte rendu de la réunion « Cœur de village » par Didier FAUREL et François MOINET :
Les étapes sont les suivantes :
1-Validation par CAUVALDOR du projet,
2-Pré-étude par un Maître d’œuvre pour un chiffrage estimatif,
3-Sollicitation par CAUVALDOR des subventions au nom de la commune. »
Ce que nous craignions vient de se confirmer : malgré ce qu’avait annoncé Benoît Chastanet lors du précédent conseil municipal, à savoir « que les habitants seront associés à chaque étape et pour le choix des travaux lors de réunion(s) publique(s) quand cela sera possible en commençant par les riverains », nous avons maintenant la confirmation, à la lecture du PV, que le projet est déjà ficelé puisque la prochaine étape est « la validation par Cauvaldor du projet ».
Encore une occasion manquée de faire participer tous les habitants de Gignac et non pas seulement ceux du bourg, parce qu’il s’agit encore une fois des finances de la commune.
➢ « Le PLUIH prend encore plus de retard pour des raisons financières, il sera poursuivi en interne et non par consultants. (à horizon juillet 2022). Sur cette période restante, il faut retravailler les dents creuses dans les hameaux, voir les terrains constructibles car dans la mesure où il y a des projets, on doit aussi travailler sur les emplacements réservés. Chacun des élus doit travailler sur son secteur pour vérifier les zonages et éviter des aberrations. »
Ce point nous amène plusieurs remarques :
1. Ce qui est dit peut ressembler à une révision du PLU déjà existant sur la commune.
2. Quels sont du coup les gardes fous pour celle-ci ? Ou comment éviter de déshabiller Pierre pour rhabiller Paul.
3. Qu’en sera-t-il des secteurs où, à priori, il n’y a pas d’élu ?
4. Quand cela va-t-il se faire ?
Et pour la notion de « dent creuse », nous vous renvoyons au document juridique que nous mettons en annexe et qui explique de manière très pédagogique de quoi il retourne.
➢ « Nous prévoyons de convier l’ensemble des habitants de la Commune le 25 septembre au Moulin pour un pot de remerciements des élus. Ce sera également l’occasion de rencontrer les nouveaux gignacois. »
Nous attendions une réunion de présentation et de discussion autour des projets et voilà qu’on nous convie à une réunion de remerciements ?
À quand une vraie réunion sur les projets de l’équipe municipale ?
Pour rappel, en septembre, cela fera un an et demi que les conseillers ont été élus !
Annexes :
Pacte de gouvernance
Procès-Verbal du conseil
Dents creuses